Pendant 3 siècles (1270-1578), les seigneurs de Lagardère ont été des personnages de l’Eglise : abbé, puis évêque de Condom, puis son chapitre. Comme dans d’autres châteaux dépendant de l’archevêque d’Auch (Lamaguère), on peut penser que le château était confié à un capitaine qui a pu s’intituler « seigneur de Lagardère », à la tête de sa garnison. Mais il y a eu également des « seigneurs de Lagardère » dans le petit village (aujourd’hui disparu, sans reste ni souvenir de château) de Lagardère-Saint Mont, fondu actuellement dans la commune de Labarthète (près de Riscle, à l’extrême ouest du département du Gers).
En 1578, le château de Lagardère passe à des nobles seigneurs laïcs, jusqu’à sa vente en 1791 à un riche habitant du village.
I – Pierre de LAVARDAC (mort vers 1585)
Il achète au chapitre de Condom le château de Lagardère le 28 mai 1578 -« contre des biens ruraux situés dans la juridiction de Gondrin et de Lagraulet » et la somme de 1142 écus, un tiers, 4 sols, et 6deniers (un écu vaut selon les époques, 4 à 6 livres).
En 1571, Lagardère rapportait au chapitre 80 livres tournois par an, et le propriétaire écrivait alors espérer tirer de sa vente 8000 livres, soit 1500 à 2000 écus.
C’est un petit seigneur local qui est qualifié de seigneur du Lian lors de la vente. Il s’agit du Lian de Gondrin qui sera sans doute la dot de sa fille lorsqu’elle épousera Caulet. Il vient habiter Lagardère, et s’y établir. C’est sans doute lui qui fait des réparations sur un château qui a subi les dégradations des troupes de Montgoméry en fin 1569. C’est un homme d’armes, catholique, qui est sollicité par son voisin Montespan pour participer au siège de Vic en juillet 1587, alors aux mains des protestants.
Dans le réaménagement du château, on perçoit son souci de défense, avec l’ouverture en pont levis côté est, protégée par l’échauguette sud est ; mais aussi les préoccupations d’un résident avec sa famille et la domesticité : dédoublement de l’étage cellier-entrepôt, escalier, peut-être fenêtres bigéminées de la « salle », nouvelles cheminées.
On trouve de nombreux Lavardac dans la région, autour d’Eauze, depuis le XIV-XV° siècle, principalement les seigneurs d’Ayzieu, au sud ouest d’Eauze, mais aussi, seigneurs de Guerre (commune d’Eauze), de Bétoulin (commune d’Eauze), de St Amand (commune rattachée à Eauze), de Campagne (ouest d’Eauze) et Projan, de Meymes, d’Aumensan.

Le plus connu est le seigneur de Blancastel (commune de Manciet à mi-chemin d’Eauze) : Bertrand de Lavardac (vers 1470-1575), qui est sûrement un parent proche des Lavardac d’Ayzieu, et de Pierre de Lavardac. C’est à Lagardère que sera signé le contrat de mariage d’une Lavardac d’Ayzieu).
C’est un valeureux compagnon de Monluc, tant en Italie qu’en Gascogne, présent à Marignan et à Naples, chargé de 300 hommes. Il a été nommé gouverneur de Mont de Marsan.
Ses voisins les plus proches qu’il fut obligé de fréquenter sont :
- Jean VI de Bezolles, seigneur de Bezolles, Beaumont, Lagraulas, Ayguetinte, blessé à Rabastens en 1570, comme Monluc, et son fils Bernard, agent farouche de la Ligue , qui attaque Panjas dans une escarmouche tout près de Lagardère, et ne fera sa soumission à Henri IV qu’en 1594.
- Hector de Pardaillan-Gondrin, seigneur de Gondrin, Roques et Justian, mais aussi seigneur de Montespan en Comminges, chef de la ligue, basé à Valence.
- son cousin Ogier de Pardaillan Panjas, d’abord compagnon de Monluc, rallié en 1571 à la reine de Navarre, peut-être, dit-on, pour être sûr d’obtenir en héritage le château de Pardaillan (actuellement commune de Beaucaire), Il est mort en 1576, son fils Charles seigneur de Pardaillan, chef huguenot, est attaqué par son voisin Bezolles…
Pierre de Lavardac fut donc un seigneur local, homme d’armes et bâtisseur.
II – Son fils Arnaud de LAVARDAC (mort en septembre 1615)
- Les guerres de religion sont finies, le pays est calme. C’est la fin du règne de Henri IV et le début de la régence de Marie de Médicis.
- Il semble avoir été un organisateur :
– le 15 mai 1590, en accord avec les consuls de Lagardère, il fait procéder à la révision du cadastre, par Jean Jacques Laffargue, arpenteur de Francescas.
– il est en procès avec le chapitre de Condom, à propos de la dîme de Lagardère. Une transaction intervient en 1599.
III – Sa fille et sœur d’Arnaud Alix de LAVARDAC
Elle apparaît comme une femme de caractère, très attachée à Lagardère, à l’occasion de la succession de son frère.
C’est une succession « à problèmes », puisque Arnaud ne laisse que deux filles illégitimes, Charlotte et Alix, et a légué le château au collège d’Auch, tenu par les jésuites.
Sa sœur Alix revendique la succession. Les jésuites d’Auch refusent le legs.
Mais Alix s’oppose alors à son mari, Jean Pierre de Caulet, seigneur de Lian, et le 3 décembre 1616, dans la « salle noble de La Gardère », par devant notaire,
« elle déclare que sollicitée par son mari de vendre…, elle se refuse à le faire, et va trouver son parent, le seigneur de Fieulx au château de Podenas, et maintient son dire que la vente ne se fera pas, malgré les mauvais traitements de son époux, qui la demande, et qu’elle ne cédera qu’à la violence… »
 Mais les dettes apportées par l’héritage sont telles qu’elle est finalement obligée de vendre en 1617. Son mari, Jean Pierre de Caulet, qui a seul le droit de le faire, lui donne alors plein pouvoir pour aliéner cet héritage.La vente n’aura lieu que quatre ans après, en 1621. Auparavant, le château de Lagardère verra le mariage de Louise de Lavardac, fille du seigneur d’Ayzieu, et cousine d’Alix, avec le seigneur de Pimbat, de la famille des seigneurs de Rozès.
Mais les dettes apportées par l’héritage sont telles qu’elle est finalement obligée de vendre en 1617. Son mari, Jean Pierre de Caulet, qui a seul le droit de le faire, lui donne alors plein pouvoir pour aliéner cet héritage.La vente n’aura lieu que quatre ans après, en 1621. Auparavant, le château de Lagardère verra le mariage de Louise de Lavardac, fille du seigneur d’Ayzieu, et cousine d’Alix, avec le seigneur de Pimbat, de la famille des seigneurs de Rozès.
L’acquéreur est un voisin Jean de Maniban, seigneur du Busca, et haut magistrat au parlement de Toulouse.Mais il n’a pas l’argent nécessaire, et emprunte les 3200 livres, prix du château et de la seigneurie, à Philippe de Pins, seigneur d’Aulagnères, près de Valence, qui s’intitule seigneur de Lagardère jusqu’au complet remboursement de la dette, neuf ans après.
IV – Philippe de PINS
Qualifié de seigneur de Lagardère, il s’occupe de son nouveau domaine. Il réside au moins transitoirement au château, mais son titre de propriété est ambigu, comme le montre un litige à propos d’une coupe de bois qu’à effectuée un tuilier de Lagardère, avec l’accord du régisseur des Maniban, mais contre l’avis du seigneur d’Aulagnères
V – Thomas de MANIBAN (mort en 1652)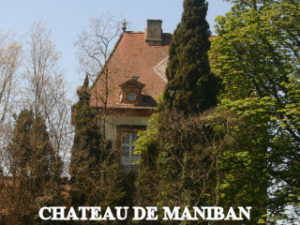
Il rembourse le prix du château à Philippe de Pins le 28 juin 1630, et prend aussitôt possession de sa seigneurie, tout en protestant « contre les ruines et destructions de toutes sortes qui se trouvent au château et au domaine de Lagardère « …C’est son père Jean de Maniban qui à fait l’achat de 1621. Il a donne « en apanage » Lagardère à son fils Thomas à condition qu’il rembourse…
La famille Maniban, est constituée à l’origine de bourgeois marchands de Mauléon d’Armagnac (à la point nord ouest du département) du nom de Labassa. En 1551, Jean de Labassa, dit de Maniban est seigneur de Lusson. Pierre, sans doute son fils épouse vers 1560 Françoise de Bousty, fille et héritière du seigneur de Busca et d’Ampeils (actuellement dans Valence).Leur fils Jean de Maniban fait une belle carrière de Magistrat qui débute à Bordeaux où il se marie dans la noblesse de robe, puis en 1614, à Toulouse , où il est nommé président au parlement. Il fait construire le château de Maniban, tout près de Mauléon, achète la seigneurie de Cazaubon, et celle de Lagardère, on l’a vu, en 1621. Il meurt vers 1630.Thomas de Maniban est un magistrat apprécié pour son activité et son adresse diplomatique. Dès 1632, il est avocat général. Il deviendra plus tard président à mortier au parlement de Toulouse.Il acquiert une grande notoriété pour son rôle majeur dans des affaires très « sensibles », dont l’intérêt, aujourd’hui, nous paraît parfois assez dérisoire :
- un conflit d’étiquette entre le parlement et l’archevêque en 1639. Le parlement exige de l’archevêque un serment à genoux chaque année… ; comme tout autre membre du parlement. L’archevêque refuse et est mis à l’amende. Le parlement,et Maniban en particulier est excommunié. Il mène les tractations qui aboutissent à une conciliation satisfaisant l’honneur des deux parties.
- un conflit plus grave entre le parlement de Toulouse et le conseil d’état. En 1643, à l’occasion du changement de règne, est établi, comme d’habitude un impôt par « droit de joyeux avènement ». Dans le Languedoc, il est appliqué de façon très dure. Maniban porte plainte au parlement qui casse l’édit du représentant royal. Les fermiers généraux en appellent au conseil d’état qui rétablit l’édit et démet Maniban de ses fonctions. Il est alors envoyé à Paris, ou il voit le ministre La Vrillières, la reine régente Anne d’Autriche et aboutit à une transaction favorable. L’histoire ne dit pas s’il a alors croisé son compatriote Charles de Batz d’Artagnan mousquetaire du roi…
- un conflit de préséances entre le parlement de Toulouse et les Capitouls, avec des querelles byzantines en 1645-1645. Après 1646, il semble s’être retiré de Toulouse. Il meurt en 1652.
Il est attaché à son domaine qui se compose de deux parties ; en bas Armagnac autour de Maniban, Mauléon, Cazaubon ; et en Fezensac autour de Busca et Lagardère.
- il fait construire le château du Busca, que l’on voit toujours et le termine en 1649,
- en 1635, il donne Lagardère en afferme pour un bail de 6 ans de 1440 livres payables chaque année ;
- en 1638, pour loger les gens de guerre envoyé sur place à l’occasions d’émeutes fiscales en Pardiac, chaque communauté doit mettre du sien. Les consuls de Lagardère ne paient pas. Lannepax, qui a du loger les soldats proteste et prend en gage un troupeau de bœufs de Lagardère. Maniban reprend le troupeau, prévient Lagardère, et permet une transaction qui amènent des remerciements des consuls de Lagardère.
- en 1639 il met en afferme le Busca et 10 métairies.

château du Busca-Maniban
Par rapport aux Lavardac, l’ambiance est bien différente.Il n’y a plus de guerre locale, et Thomas de Maniban est le symbole de la réussite d’une noblesse de robe experte dans les rouages administratifs de plus en plus complexes de l’état. Le seigneur confie son domaine rural à des exploitants qui le paient. Il vit et agit essentiellement dans la capitale provinciale, ou même à Paris…
VI – Son fils Jean-Guy de MANIBAN (mort en 1717)
Il joue un rôle plus effacé au parlement de Toulouse, où il devient président à mortier en 1683.
Dans le pays, il arrondit son domaine : il acquiert Massencome en 1674 et Tilladet vers Gondrin en 1676.

château de Mansencome
Il devient marquis de Maniban en 1681, augmente la partie de don domaine située en bas-Armagnac de Toujouse, Monguilhem en 1685, de Campagne et d’Ayzieu, autrefois fief des Lavardac, en 1701. Comme son père, il afferme ses domaines : en particulier Lagardère à François Cugneau, grand propriétaire du village, en 1685. Le bail sera renouvelé.
Son voisin est moins discret que lui : Beaumont, appartenait aux Bezolles, Montespan, de la famille des Pardaillan Gondrin y est exilé, lorsque son épouse devient la maîtresse officielle du roi et qu’il proteste violemment.
Un peu plus tard son fils légitime deviendra duc d’Antin et sera comblé des faveurs du roi, jusqu’à laisser son nom à Paris…
VII – Jean Gaspard de MANIBAN (1686 – 31 août 1762)
C’est le membre le plus célèbre de la famille. C’est un grand seigneur digne représentant de la haute noblesse de robe.Il va à Paris en 1707 épouser la fille du président Lamoignon du parlement de Paris, oncle du futur ministre Malesherbes. Il revient sûrement à plusieurs reprises à Paris, où il a noué des relations importante à travers sa belle famille. C’est bientôt la régence (1715-1723), le système de Law et le triomphe du « bossu », selon Paul Féval… Chacun peut imaginer un lien entre les deux célébrités…Il est conseiller au parlement à 20 ans en 1706, président à mortier en 1714, à 28 ans, il devient premier président du parlement de Toulouse en 1722, à 36 ans, et le reste 40 ans, jusqu’à sa mort.
- C’est un grand magistrat consciencieux et zélé, très absorbé par sa tâche, autoritaire et dominateur mais affable et courtois, urbain et « d’une gaîté décente » avec ses subordonnés. Sa présidence est marquée par la solennité et la grandeur. Il organise à Toulouse des réceptions somptueuses.
- Il est austère, de tendance janséniste, conscient de représenter la morale et le bien public et d’être un des tout premiers grands serviteurs de l’état, qui doit savoir s’opposer, si nécessaire au gouvernement du roi. A la mort du régent et du cardinal Dubois, en 1723, devant les assemblées réunies il lève les mains en signe de bénédiction
- En 1727, pendant les inondations de Toulouse, il organise les secours. Il fait partie de l’académie des Jeux Floraux.
- En 1728 – 1732 il s’oppose à l’enregistrement de nouveaux impôts, comme d’autres parlements.
- En 1761 le parlement organise le procès Calas, mieux connu par les libelles de Voltaire. Il ne semble pas y avoir participé.
- En 1762 il commence l’instruction du procès des Jésuites, machination politique qui aboutira à la dissolution de l’ordre en 1763, mais il tombe brusquement malade et meurt sans avoir pu présider le procès le 31 août 1762.
- localement, il vient chaque année dans son château du Busca et renouvelle régulièrement les baux à fermes, en particulier de Lagardère.
Il est bien différent de ses voisins :
- Pardaillan est passé par héritage aux Baudéan de Parabère. Le seigneur, gouverneur du Poitou, laisse en 1716 une jeune veuve Marie-Madeleine de la Vieuville, qui brille à Paris à la cour du Régent dont elle devient la maîtresse. Elle est connue comme « la Parabère », organise des fêtes, en particulier dans sa maison d’Asnières…
Le château de Herrebouc, à Saint-Jean Poutge est la résidence des seigneurs de Verduzan, titrés marquis de Miran, un hameau de la commune de Rozès. Jean-Jacques de Verduzan (1695-1760) est d’abord un homme d’armes au service du roi. Il est mousquetaire. Mais bientôt il se retire à Herrebouc et se consacre à l’amélioration de ses terres, à l’étude et à la poésie. Il est en relation avec tout un réseau d’intellectuels fortunés caractéristiques de l’époque des lumières, ouverts, soucieux d’améliorations économiques (comme les « Physiocrates » un peu plus tard ), cultivés et d’esprit voltairien. Son fils, moins brillant que lui, obtiendra de l’intendant d’Etigny la concession des eaux thermales du Castéra, et fera bâtir, à côté des nouveaux thermes un joli château XVIII°, maintenant disparu…Ni la Parabère, ni Verduzan, ne devaient être vus d’un bon œil par le marquis de Maniban, très austère, même s’il était aussi très cultivé.

château de Herrebouc
VIII – Marie-Christine de MANIBAN
Marquise de LIVRY, deuxième fille du Président Jean Gaspard, est la dernière de la famille.
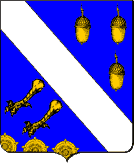 Elle hérite de tous les biens de son père. Mais c’est une parisienne. Elle a épousé le marquis de Livry (sur Seine), premier Maître d’Hôtel du roi, et quand elle n’est pas à la cour, vit l’hiver à Paris rue de l’Université, et l’été à Soisy sous Etioles.
Elle hérite de tous les biens de son père. Mais c’est une parisienne. Elle a épousé le marquis de Livry (sur Seine), premier Maître d’Hôtel du roi, et quand elle n’est pas à la cour, vit l’hiver à Paris rue de l’Université, et l’été à Soisy sous Etioles.
Elle se débarrasse petit à petit de ses propriétés gasconnes :
- en 1780 elle vend le Busca au marquis de Faudoas, mais le reprend faute d’être payée. Elle le revend en 1803 au Dr Rizon, de Gondrin, dont les descendant sont toujours propriétaires.
- en 1791, elle vend le château de Lagardère avec la métairie de La Bourdette qui en dépend à un des plus riches Lagardérois : Jean Délas, de La Bordeneuve (actuellement Le Mulé) frère du premier maire de la toute nouvelle commune de Lagardère.